Quand les citoyens deviennent architectes de choix : les escouades nudges et la consommation au quotidien
Introduction
Pourquoi, même en sachant ce qui est « bon » pour nous ou pour la planète, choisissons-nous souvent le contraire? Nous savons qu’il est préférable de marcher plutôt que de prendre la voiture, de manger plus de légumes que de viande, ou encore de réduire notre consommation d’énergie… et pourtant, dans la vie de tous les jours, nos gestes ne suivent pas toujours nos convictions.
C’est ici qu'entrent en jeu les nudges — ces « coups de pouce » qui modifient subtilement notre environnement pour rendre les comportements souhaitables plus faciles, visibles ou attrayants. Mais une question demeure : qui devrait concevoir ces nudges? Les experts? Les gouvernements? Et si c’étaient… les citoyens eux-mêmes?
C’est l’idée qu’a explorée un projet de recherche participatif mené récemment au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en formant des escouades nudges citoyennes.
Les nudges en quelques mots

Un nudge est une petite modification de l’« architecture de choix » qui influence nos décisions sans supprimer d’options ni imposer de contraintes. L’exemple le plus connu : placer des fruits à hauteur des yeux dans une cafétéria, sans enlever les desserts.
Les nudges reposent sur une réalité bien documentée : nos biais cognitifs. Nous prenons rarement nos décisions de manière parfaitement rationnelle. Nous sommes influencés par l’ordre des options, les comparaisons sociales (« mes voisins consomment moins d’énergie que moi »), ou encore la façon dont l’information est présentée.
Ce qui distingue un nudge :
- Il ne supprime pas les « mauvaises » options.
- Il ne repose pas sur des récompenses financières.
- Il est peu coûteux et facile à mettre en place.
Mais la plupart des initiatives de nudges sont conçues de manière top-down : par des experts ou des institutions qui décident des « bons comportements » pour les citoyens. Une approche efficace… mais parfois critiquée pour son paternalisme.
L’expérience des escouades nudges citoyennes
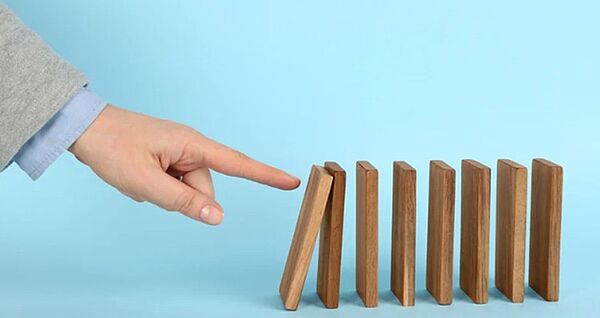
Et si l’on changeait de perspective ? Et si, plutôt que d’être les « nudgés », les citoyens devenaient eux-mêmes les architectes de leurs propres choix ?
C’est ce qu’a tenté un projet de recherche, dirigé par la professeure Laure Saulais du département d’économie agroalimentaire et des sciences de la consommation, visant à mobiliser les sciences comportementales en appui à la transition socio-écologique dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le processus était simple mais puissant :
- Recruter un pilote pour chaque escouade (ex. une conseillère municipale, une éco-conseillère de cégep).
- Former une escouade nudge composée de citoyens ou d’acteurs du milieu.
- Offrir une formation de 2 heures en économie comportementale, combinant notions théoriques et exercices pratiques.
- Identifier des comportements écoresponsables déjà possibles dans le contexte, mais peu choisis.
- Observer le quotidien et le contexte de choix afin de tenter de comprendre pour les choix écoresponsables ne sont pas optimalement choisis.
- Élaborer collectivement des idées de nudges pour rendre ces comportements plus attrayants, et les présenter aux architectes de choix qui peuvent mettre en place les interventions en question.
Trois escouades ont ainsi vu le jour :
- Saguenay–Lac-Saint-Jean (2023)
- Petit-Saguenay (2024)
- CÉGEP de Jonquière (2025)
Le résultat ? Un fort sentiment de mobilisation et de découverte. Comme le disait une participante : « Au début, je ne savais pas du tout dans quoi je m’embarquais… Mais au final, c’est wow! Pertinent pour mon travail et ma vie quotidienne. »
Quelques exemples concrets de nudges locaux
Les idées générées par les escouades sont variées, souvent créatives, et surtout adaptées au contexte local. En voici quelques exemples :
Petit-Saguenay
La petite municipalité a réfléchi à des moyens de valoriser la marche plutôt que la voiture pour les déplacements à l’intérieur du village. L’une des suggestions : installer des panneaux aux entrées du village indiquant « Village de marcheurs ! ». Ce simple message transforme un geste banal en une norme sociale positive et valorisée.
CÉGEP de Jonquière
Ici, l’escouade était composée de responsables de la cafétéria, des communications, des immeubles et de la santé et sécurité au travail. Parmi leurs idées, l’une illustre bien la puissance du rephrasage : plutôt que d’annoncer une « soupe aux tomates » sur le menu de la cafétéria, pourquoi ne pas offrir un « concassé de tomates séchées au soleil d’Italie » ? Le plat reste le même, mais l’attrait change complètement. Ce type de nudge joue sur le cadrage de l’information et rend une option végétarienne plus séduisante.
Autres thématiques explorées
Au-delà du transport et de l’alimentation, les escouades ont aussi réfléchi à des nudges pour :
- La consommation d’énergie (ex. mettre de l’avant l’information que les employés du CÉGEP peuvent faire ajuster leurs calorifères s’il chauffe trop, et ce, afin qu’ils n’aient pas à ouvrir leurs fenêtres l’hiver).
- La gestion des matières résiduelles (ex. simplification des consignes de tri).
- La santé et sécurité au travail (ex. déplacer les machines pour sécher les bottes pour favoriser leur utilisation).
Ces exemples illustrent un principe clé : les « bonnes options » existent déjà, mais elles ne sont pas toujours les plus évidentes ni les plus attrayantes.
Pourquoi ça nous concerne tous comme consomm’acteurs

Nous sommes tous influencés, chaque jour, par l’architecture de choix qui nous entoure. Le positionnement des produits à l’épicerie, les portions proposées dans un restaurant, les paramètres par défaut de nos applications… tout cela façonne notre consommation sans qu’on s’en rende compte.
Comprendre les nudges, c’est mieux comprendre pourquoi nous consommons comme nous le faisons. Mais c’est aussi réaliser que nous pouvons, collectivement, concevoir des environnements qui rendent nos choix plus cohérents avec nos valeurs.
Autrement dit, nous ne sommes pas seulement des consommateurs influencés : nous pouvons devenir des consomm’acteurs, capables d’imaginer des solutions pour nous-mêmes et nos communautés.
Conclusion et ouverture
Les escouades nudges citoyennes du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont montré qu’il est possible — et, même, particulièrement mobilisateur — d’impliquer directement les citoyens et acteurs locaux dans la conception d’interventions comportementales. Loin d’un modèle top-down, cette approche bottom-up répond à une critique importante : celle de la légitimité des interventions de type nudge.
Plutôt que de subir des nudges, les citoyens deviennent co-créateurs de leurs propres environnements de choix.
Et cette idée ne restera pas confinée à un projet de recherche. Elle est aujourd’hui en voie de se transformer en offre de service concrète : accompagner des municipalités, écoles et organisations de tous genres (ex: hôtels, restaurants) à créer leurs propres escouades nudges participatives.
Parce que changer nos comportements, ce n’est pas seulement une affaire d’individus isolés. C’est une aventure collective où, ensemble, nous pouvons apprendre à rendre nos choix plus durables, plus sains… et plus alignés avec nos valeurs.
Claudia Laviolette
Chercheuse et entrepreneure